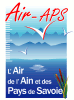
Mesures
L’ensemble des mesures entreprises confirme très largement la grande sensibilité des vallées alpines, parfois plus polluées que les grandes zones urbaines : les émissions y sont plus faibles, mais dans ces sites où la topographie et la météorologie sont parfois très pénalisantes, les niveaux de concentration peuvent localement augmenter par accumulation et une évolution en système quasi fermé. Cette situation est particulièrement marquée pour les espèces primaires, durant les périodes anticycloniques hivernales sous inversion de température. Durant ces périodes, les sources locales jouent un rôle prépondérant et l’influence du transport atmosphérique régional semble très faible. En revanche, contrairement à la majorité des autres zones du territoire national, les vallées alpines bénéficient en période estivale de très bonnes conditions de dispersion (en raison des vents thermiques très développés) qui épargnent aux fonds de vallée les épisodes photochimiques notamment liés à l'ozone. A cette période, les apports régionaux ont plus d’influence qu’en hiver, mais ne sont pas nécessairement prépondérants : un bon exemple est celui des épisodes de poussières désertiques qui ont du mal à pénétrer en fond de vallée. Au final, les situations « à risque » (au sens de la législation sur la qualité de l’air) sont donc très majoritairement rencontrées en hiver, et concernent essentiellement des espèces émises localement, dont les PM10 et les NOx.
Cependant, il est essentiel de mentionner que l’on rencontre très souvent de très fortes hétérogénéités spatiales des concentrations au sein des vallées (dans des proportions qui peuvent être de 1 à 50 sur quelques dizaines de mètres), ce qui va à l’encontre d’une notion de « pollution globale des vallées ». Les concentrations varient fortement selon l'altitude ou la localisation par rapport aux sources : en été les plus fortes concentrations de polluants photochimiques se trouvent sur les zones sommitales alors que les fonds de vallée sont "épargnés" ; en hiver les polluants primaires (émissions dues aux véhicules, chauffage, et industries) se concentrent dans des zones proches des lieux d'émission, alors que les plus hautes altitudes ou les zones plus rurales sont relativement préservées. Cela dit, ces deux caractéristiques globales (impact respectifs des sources locales et régionales, et hétérogénéité des sites dans la vallée) sont plus nettes pour Chamonix que pour la Maurienne, très probablement en raison d’une plus grande ouverture de cette dernière vallée.
A ces processus s’ajoutent des spécificités liées à la recirculation de polluants dans des « couches réservoir » plus ou moins couplées à la couche de surface selon les évolutions thermiques en cours de journées. Ces stratifications complexes commencent à être mise en évidence grâce aux moyens de mesure tridimensionnels employés lors des deux dernières campagnes (LIDAR, profileur de vent, ULM instrumenté, ballon captif), mais la compréhension de leurs évolutions n'est encore que très partielle.
Il convient de rappeler qu’un bilan chiffré précis de la part respective des émissions issues des différentes sources de pollution s’attache nécessairement à un lieu, à une espèce chimique, et à un moment déterminés. En ce sens, on ne peut pas parler de « part du trafic à la pollution des vallées ». Les mesures de profils de COV, des PM10 et de leur spéciation chimiques (HAP, carbone organique (OC) et élémentaire (EC), …) en différents points des vallées permettent de montrer qu’à l'évidence, d’un point de vue global, le trafic routier des poids lourds semble responsable d'une large part des concentrations atmosphériques mesurées pour les espèces d'origine anthropique, aussi bien en Maurienne qu’à Chamonix. Cependant, l'influence d'autres sources est visible également, notamment en ce qui concerne le chauffage individuel et plus particulièrement celui au bois, ainsi que les activités industrielles (en Maurienne). Par exemple, pour le site fixe du réseau de surveillance à Saint Jean de Maurienne, on peut évaluer une part moyenne due au trafic routier poids lourds de l’ordre de 70 % pour les concentrations de NO, mais de 30 % pour les PM10 pour les jours ouvrés. Au sein des particules, cette part est de l’ordre de 35% pour EC, mais seulement de 8 à 10 % pour OC. Des mesures de molécules traceurs des émissions des feux de bois indiquent, pour la zone sub urbaine de Chamonix en hiver, une contribution moyenne de l’ordre de 20% de cette source au carbone organique des PM10. Cette estimation augmente pour des zones plus rurales.
Cette diversité des sources, ainsi que l’hétérogénéité géographique, associée à une dépendance forte aux conditions météorologiques, expliquent en partie pourquoi les données acquises aux sites de référence de l’AIR APS (en milieux urbains) et considérées sur un temps court (heure ou jour) ne mettent pas en avant de façon nette des changements directement liés à la fermeture puis aux phases de réouverture du Tunnel du Mont Blanc. Ces changements sont par contre très perceptibles pour les sites influencés en bord de route.