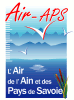
Modèle
La chaîne développée pour la modélisation déterministe permet d’obtenir une vision des processus mis en jeu plus globale que celle obtenue par les seules mesures. Le fait que cette modélisation procure des résultats cohérents est déjà une avancée en soi, dans la mesure où cette utilisation à de très petites échelles (maillage de 300 à 1000 m) est très novatrice.
Les résultats obtenus pour une période d'été par la modélisation indiquent que les concentrations d’ozone relevées dans les deux vallées sont très majoritairement liées au niveau de fond régional. Considérées dans leur volume global, les vallées ne produisent pas d’ozone, mais en consomment par titration avec le monoxyde d’azote dans les zones d’émissions anthropiques. On notera que, contrairement à de nombreux autres types de sites, le régime de production de l’ozone est à l’heure actuelle, en été, limité dans chacune des vallées par les concentrations des composés organiques volatils. Les résultats d’hiver confirment que les concentrations sont majoritairement dominées par les émissions locales à cette période de l’année. In fine, ces situations sont donc plus délicates à simuler, dépendant très fortement à la fois de la précision des cadastres d’émission, du réalisme du traitement des profils verticaux de température près du sol, et de la paramétrisation des processus de dépôt.
Les cadastres d’émission aboutissent en eux-mêmes à des résultats intéressants, en particulier pour ce qui est des scénarios. Ils montrent par exemple que même une augmentation du trafic poids lourds de 50% par rapport à 2003 conduit, pour 2010, à des réductions très sensibles de ces émissions, compte tenu de l’évolution des normes, et ce, pour les deux vallées. L’impact d’un passage “tout chauffage au gaz” est aussi très marqué. Il conduit, par exemple pour Chamonix, à réduire les émissions totales de SO2, PM, CH4 et COVNM respectivement de 80, 26, 19 et 2% (toutes choses égales par ailleurs), avec une légère augmentation du CO de 5%. On retiendra cependant que ces cadastres nécessitent encore des améliorations, en particulier pour le traitement des sources des PM.
Les différents scénarios d’émission couplés aux différents cas météo mettent tous en évidence une diminution sensible des émissions des composés primaires dans les vallées. Si l’on regarde la moyenne annuelle reconstituée à partir des 5 classes météo majoritaires, le scénario 3 (-50% de PL) est celui qui apporte la plus forte diminution de NOx dans les vallées suivi de très près par le scénario 4 (passage au gaz naturel). En ce qui concerne la diminution des PM10, le scénario 4 (passage au gaz naturel) est celui qui apporte (dans l’état actuel des cadastres) les plus fortes réductions de concentration.
Sans conteste, et même si les mesures permettent une vision plus fine de certains aspects liés à la qualité de l’air, un des débouchés majeurs de ce programme est la mise en place d’un outil de modélisation permettant l’étude des scénarios. Cet outil a montré sa pertinence dans un contexte de vallées encaissées ou une spatialisation fine des résultats est indispensable, et apporte déjà des résultats innovants sur les impacts potentiels de tels ou tels types d’évolution de sources d’émissions. Il reste cependant perfectible, en particulier pour ce qui concerne les particules.